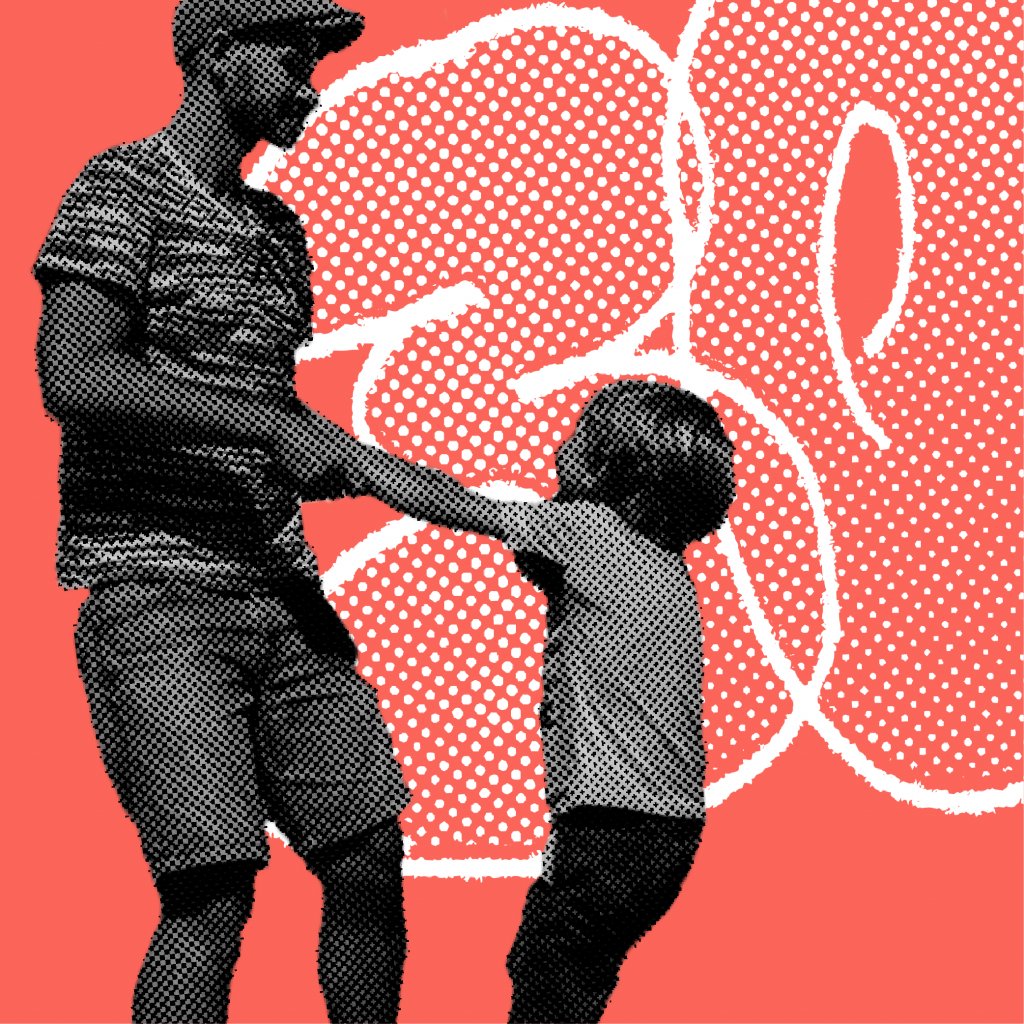Le 10 septembre, vous êtes venu·e·s nombreux·e·s pour fêter les 30 ans de la Friche. Retour en images sur cette fête incandescente et rassembleuse.

« Aujourd’hui encore, je n’ai pas tout compris à ce qu’il s’est passé ». Trente-et-un ans après la création de Système Friche Théâtre, structure pilote de la Friche la Belle de Mai, Philippe Foulquié, cofondateur et directeur du projet de 1990 à 2011, reste étonné. Qui aurait pu deviner que l’histoire de la résurrection de cette usine abandonnée serait si belle ? Quand il retrouve Christian Poitevin, l’adjoint délégué à la Culture qui, à l’époque, lui a offert la liberté de faire ce qu’il voudrait de cette ancienne manufacture des tabacs, les souvenirs abondent. L’élu poète, qui, sous son nom de performeur Julien Blaine a été célébré en 2020 par la Friche et l’activiste culturel, spécialiste des marionnettes, qui a dirigé, en duo avec Alain Fourneau puis seul, le devenir de cette fabrique artistique sans égal, sont restés amis.
Retour sur les premières années de la Friche la Belle de Mai avec ceux qui peuvent en revendiquer la paternité.
Entretien croisé mené par le journaliste Gilles Rof


Quel est votre parcours avant cette aventure de la Friche la Belle de Mai ?
Christian Poitevin : Avant cette date, je suis un poète et un patron de presse et l’un aide l’autre à vivre. Christian Poitevin est le mécène de Julien Blaine. En février 1989, je suis élu au conseil municipal de Marseille sur les listes de Robert Vigouroux et là, je dois choisir entre la direction de l’Autre Journal à Paris où je gagne une fortune et adjoint à la culture du maire de Marseille, qui paye une misère. Cela me prend trente secondes. Avec Michel Butel, le patron de l’Autre Journal, on a pleuré très longtemps dans les bras l’un de l’autre.
Je me suis retrouvé troisième adjoint dans la hiérarchie municipale : cela montrait une volonté très forte de faire de la culture une priorité. Pendant six ans, j’ai mis mon présent d’artiste au passé. Complètement.
Philippe Foulquié : Je travaille dans la culture depuis le début des années 70. J’ai vécu une vingtaine d’années à Paris et suis revenu dans le midi. Je dirigeais un festival à Mougins (06) et j’étais devenu le grand spécialiste français des marionnettes. J’ai appris que Dominique Wallon, le directeur des affaires culturelles de Marseille, cherche un projet pour un lieu qui se libère. Je l’ai appelé pour lui dire que je voulais créer un théâtre où l’on pourrait explorer la marionnette, un art populaire qui n’est plus soutenu et qu’on a enfermé dans le jeune public. On ouvre le Massalia, premier théâtre permanent de marionnettes en France, rue Grignan en 1987 [dans les locaux occupés un temps par le théâtre quotidien de Marseille de Michel Fontayne]. Je ne connaissais pas Christian, mais je vais le voir au Provençal, où il a son bureau, pour qu’il entre à mon conseil d’administration. Quand il arrive à la mairie deux ans plus tard, il fait un courrier à toutes les institutions culturelles et annonce qu’il entend notamment soutenir trois démarches : François-Michel Pesenti [metteur en scène], Alain Fourneau [fondateur du théâtre des Bernardines] et Philippe Foulquié. D’un coup, on devient les chouchous !
C’est étrange comme démarche ?
C.P : J’ai écrit cela noir sur blanc ! J’arrivais après 40 ans de Defferrisme où la culture à Marseille, c’était Edmonde, dont on disait qu’elle était adjointe par « délégation conjugale », le théâtre national de Marseille « Marcel Maréchal », le ballet national de Marseille « Roland Petit »… Et l’opéra.
Il fallait prendre le pouvoir, et vite. J’ai convoqué tous les chargés de mission pour leur donner deux axes : mélange des cultures et mélange des disciplines… Marseille, c’est quoi ? Le multiculturalisme, la richesse de ces putains de populations qui arrivent de toutes parts, ce va-et-vient ininterrompu de tout ce qui est immigré dans le monde et surtout dans la Méditerranée. Et, pour moi, ce qui fait l’art contemporain, c’est le mélange des disciplines culturelles. Comment le cinéma, c’est la poésie ; la poésie, c’est la danse ; la danse, c’est les arts plastiques… Et comment tout cela peut se mélanger aux cultures méditerranéennes présentes ici, pour faire de l’art contemporain.
Votre père, André, était un proche de Gaston Defferre et le PDG du Provençal, est-ce que s’appeler Poitevin vous a facilité la tâche ?
C.P : La seule organisation dont j’ai fait partie dans ma vie, c’est la Confederacion nacional del Trabajo, [CNT] le syndicat anarchiste espagnol… J’avais 13 ans ! J’étais copain avec Robert Vigouroux parce que c’était un peintre du dimanche, qui, au lieu de faire des marines et des compotiers, peignait à la Piet Mondrian… En 1986, il avait succédé à Gaston Defferre comme maire. En me prenant en 1989, il savait qu’il faisait passer un Poitevin dans son camp, ce qui était très bien joué face à Michel Pezet et au parti socialiste. Mais ce qui m’a vraiment aidé dans cette affaire, c’est plutôt Julien Blaine et ma carrière d’artiste. J’ai vécu les années 60, 70, 80 dans cette culture des provo, des marginaux… J’ai fait le tour du monde des friches industrielles. Milan, Gênes, au Dégrossissage de l’or à Genève, Amsterdam, Berlin… Donc, premier point, je savais que ça se passait là. Et deuxième point, je voulais montrer que l’Etat abandonne Marseille, comme toujours. Sous Mitterrand comme aujourd’hui sous Macron, pour les gouvernements successifs, cette ville n’est pas en France.
P.F : En 1990, Marseille touche le fond de la crise… Moi, j’aimais l’idée qu’un élu à la culture se dise que ces 700 hectares de friches industrielles, il faut les exploiter. Puisque les investisseurs ne viennent pas, ouvrons-les ! Je trouvais cela très juste, très dynamique. D’autant que j’étais dedans.
C.P : Friche industrielle, c’est un mot génial. Friche, cela vient de la terre. Industrie, c’est le monde ouvrier. C’est un mot valise absolument extraordinaire. Surtout quand tu dis, on va tout y faire ! Il fallait rentabiliser cela, que ces usines restent des lieux de vie…
On l’a presque oublié, mais l’histoire de la Friche ne commence pas à la Belle de Mai
P.F : En juin 1990, Alain Fourneau, [qui codirigera la Friche jusqu’en 1993] m’appelle et me dit : « Poitevin gamberge sur un projet de friche, viens, on va lui faire une proposition ». On avait monté ensemble un spectacle de Tadeusz Kantor [Je ne reviendrais jamais] et trouvé une façon de travailler. On s’entendait plutôt bien. Quand on est arrivé dans le bureau de Christian, on a eu l’impression qu’il savait déjà ce qu’on allait lui dire. Il n’a pas du tout été surpris qu’on vienne le voir ensemble.
C.P : Cela allait de soi. Fourneau et Foulquié étaient les deux personnes, avec Pesenti, qui, à Marseille, essayaient de faire quelque chose de nouveau. Par rapport à leur propre création mais surtout par rapport à la ville. L’un, avec son histoire de conquêtes de nouveaux territoires, l’autre avec ses marionnettes, ils avaient compris qu’il pouvait se passer quelque chose.
P.F : Quand Christian nous dit banco, on se met à bosser. Je propose à Fabrice Lextrait, qui venait de finir ses études, de nous rejoindre en tant qu’administratif. Il est tout de suite parti en chasse avec le directeur technique de Massalia. Ils ont trouvé une friche au boulevard Magallon [15e arrondissement, quartier des Crottes]. Un lieu avec plusieurs étages et des volumes scénographiques intéressants. Nous sommes restés là un an. Le propriétaire nous assassinait au loyer et cela nous bouffait le budget ! Mais, on en a tiré des enseignements.
Lesquels ?
Un exemple : le jour de l’inauguration, on avait commandé un buffet, mais on avait trop pris. Le lendemain, on ressert le buffet… Et ça marche. Depuis, il y a toujours eu à manger à la Friche pour les artistes comme pour le public, même quand le restaurant n’existait pas. Aujourd’hui, tous les théâtres ont un restaurant, mais à l’époque, ce n’était pas la priorité.
Quel est le projet de cette Friche ?
P.F : Massalia est la propédeutique de la Friche. Cela n’existe pas un théâtre de marionnettes en France, il faut l’inventer. La Friche, c’est pareil. Il n’y a pas d’école de directeur de friche. On explore. Et on est libres. On a un élu qui ne nous emmerde pas. Aujourd’hui, je vois mes copains qui n’arrêtent pas de répondre à des appels d’offres. C’est-à-dire qu’il y a des fonctionnaires dans des bureaux bien chauffés qui décident des projets qu’il faut faire. On en est là : une bureaucratisation de la culture à un niveau incroyable.
Christian, lui, nous a juste dit : « Allez dans les friches… ». Au bout d’un an, il a quand même précisé : « Oh, les copains, il ne faut pas faire que du théâtre. J’ai dit interdisciplinaire ! ».
Il a fallu insister pour tenir cette idée de multidisciplinarité ?
P.F : La première année, on s’est fait avoir. Tout d’un coup, il y avait des espaces et des financements qui nous permettaient de faire les choses qui restaient dans nos bagages depuis des années. Mais il n’y avait ni exposition, ni concert… Fabrice Lextrait est allé voir Didier Urbain, le patron du journal Taktik, qui était très branché musique. On a fait une grande soirée de concerts en clôture boulevard Magallon.
C.P : Si tu restes entre gens de théâtre, cela ne va pas fonctionner. C’est ce qui a, très vite, fait la force de la Friche. Des gens se sont rencontrés et ont fondé des projets différents parce qu’ils étaient, d’origine et de disciplines culturelles différentes. Un autre mythe fondateur, c’est le nomadisme. J’avais cette idée de réussir un truc à la Belle de Mai et hop, d’aller investir un autre lieu. Jusqu’en février 1995, mon idée était d’avoir une structure nomade capable d’aller conquérir d’autres territoires. Mais j’ai démissionné avant.
Comment réussissez-vous à récupérer cette friche immense qu’est la Manufacture des Tabacs ?
P.F : À l’automne 1990, il y a eu une visite de la Seita. Fabrice Lextrait y est allé et a pris rendez-vous avec le directeur du patrimoine immobilier, M. De Montgolfier. Ce dernier s’est renseigné auprès de la mairie. Christian a crédibilisé notre candidature.
C.P : Quand j’entends qu’on va déloger la Seita pour l’envoyer à Vitrolles, je suis fou… Comment expliquer qu’on abandonne la plus grande usine de Marseille, qui fait des bénéfices ? Au lycée, on allait la visiter en « études du milieu », pour voir comment fonctionnent les ouvriers, les employés. On repartait tous avec une cigarette d’un mètre vingt.
La patronne est la femme d’un membre du Parti socialiste. Elle me dit « On peut vous le vendre… ». Je lui réponds : « C’est pas grave. Dans six mois, c’est squatté. Dans douze, c’est une ruine… » Robert [Vigouroux] entre dans le jeu. Je suis aussi allé voir l’union locale syndicale CGT qui nous a beaucoup aidés. Au final, on l’a eu pour un franc symbolique.
P.F : On a signé une convention d’occupation de l’îlot 3, 45 000 mètres carrés… Et la Seita payait même l’impôt foncier. Un coup génial !
C.P : Aujourd’hui, cela n’a pas de prix. D’ailleurs, j’attends toujours les remerciements des municipalités qui se sont succédé… Le plus drôle, c’est que quand Vigouroux a tracé le périmètre d’Euroméditerranée, il a oublié de mettre la Friche dedans. Il a fallu que je lui dise de la rajouter…
P.F. : Euroméditerranée a été une opportunité formidable pour la Friche. La mission de configuration ne savait pas qu’on était à la Seita. Quand ils s’en sont aperçus, ils ont ajouté un groupe culture à leurs groupes de travail. Et à la fin, la zone de la Friche est devenue la septième Zac d’Euromed : la Zac Culture. En reprenant l’idée que nous avions que la culture pouvait être une alternative économique pour redynamiser un site obsolète, parce qu’abandonné par l’industrie. L’idée des trois îlots part de là. Aujourd’hui, cette zone est aussi dynamique qu’une usine. En équivalent emplois, la Friche, c’est 1500 emplois. Dix ans avant sa fermeture, la Seita employait 1000 personnes.
Philippe, vous souvenez-vous de votre arrivée à la Friche ?
P.F : La Belle de Mai, c’est un monstre. C’était passionnant mais cela m’a paniqué. Quand tu vois ce lieu, tu te dis, mais par quel bout on va le prendre ? Au Massalia, rue Grignan, la scène avait quatre mètres d’ouverture. C’était sympa, mais très limité. Quand nous avions besoin d’espace, on produisait ailleurs : dans le parc Billoux avec Gatti, à la plage…
C.P : Moi qui étais à la fois « l’élu de tutelle » et spectateur lambda, la panique de Philippe, je ne l’ai jamais vue. Quand on est entrés dans la Friche, c’était à nous. Tout. La preuve, c’est que l’une des premières choses que l’on a faites, c’est le spectacle d’Armand Gatti, « Adam quoi ? », et qu’il a occupé tout l’espace. Et comme cela ne suffisait pas, il a aussi occupé les abords de la Friche, l’extérieur.
P.F : Les artistes ont exploré et inventé la Friche avec nous. Il y avait un espace, la Cartonnerie, où l’on pouvait faire ce que l’on voulait parce que c’était un volume sans colonnes. Sinon, partout ailleurs, tu te confrontais aux espaces. Marie-Christine Soma, une très grande créatrice lumière, a fait danser les colonnes en mettant des lumières sur un rail. Xavier Marchand a utilisé une salle qu’on appelait la « salle bleue », parce que les vitres étaient peintes en bleu pour protéger le tabac : une femme allait tout au fond et on l’imaginait se noyer. C’était magnifique.
La Friche la Belle de Mai n’était ni un lieu municipal, ni un lieu autogéré
C.P : Je ne voulais que cela soit un lieu institutionnel recevant le soutien du département, de la région, voire de l’état… Mais, en échange, pour que ça marche, il fallait que les artistes prennent cela en charge. Philippe l’a fait. C’est vrai que j’étais derrière pour soutenir, mais c’est lui qui a géré la Friche. Pas moi.
P.F : C’est aussi le résultat de la décentralisation, dont les lois datent de 1983 et dont le porteur s’appelle Gaston Defferre, maire de Marseille. Cela a libéré des énergies. Quand on invente la Friche, ce sont des opérateurs culturels et un élu local. Et cela a servi de modèle partout. D’ailleurs, pendant les vingt ans de ma direction de la Friche, nous avons eu un conflit presque permanent avec le ministère de la Culture, sûrement le plus centralisateur de tous, parce qu’il ne m’avait pas nommé.
La Friche était un projet qui n’avait pas de projet, mais qui n’arrêtait pas de passer le futur au présent.
Philippe Foulquié
Quel regard porte Robert Vigouroux sur vos propositions ?
C.P : Robert m’a foutu une paix royale. On a eu des clashes sur des questions politiques, mais sur la culture, jamais. Moi, je n’avais pas de carrière à préparer. Ni député, ni sénateur, ni maire… Je voulais que Marseille gagne. Ce que je cherchais, c’est trois pages dans Libération, deux pages dans Le Monde, que la télé parle de la ville… Et à ce niveau-là, on a cartonné ! Après six ans de Vigouroux, l’image a totalement changé : on est passé de la French connection à la culture. Avec Bernard Blistène à la direction des musées, Philippe Foulquié à la Friche, Philippe Vergne au Mac, des expositions comme Poésure et peintrie, qui a été reprise partout, on savait pourquoi il fallait venir à Marseille !
Au niveau financier, la Friche représente quoi dans le budget de la municipalité ?
C.P : Déjà, il faut savoir que l’opéra prend 50% des subventions culturelles. Et que quand j’arrive à la mairie, la culture pèse 3,5% du budget annuel. Quand je m’en vais, elle atteint 8,2%. Cela laisse de la marge. Et la Friche, c’est la structure qui pompait le plus dans les marges. Mais à côté de l’opéra, cela n’a rien à voir.
P.F : La première subvention, c’était 1,1 million de francs, uniquement par la ville. L’État et le département sont arrivés plus tard. À la fin du mandat de Christian, on a eu une augmentation. On s’en tirait à peu près. Massalia et les autres structures étaient subventionnées aussi. Et puis, il y avait des financements spécifiques sur certains projets, comme celui d’Armand Gatti.
Qui sont les leaders artistiques de ces premiers moments ?
P.F : L’artiste qui inaugure la Friche, c’est Jean-Pierre Larroche. Qui, jusqu’à mon départ, a créé tous ses spectacles à la Belle de Mai. Il n’a pas la notoriété d’Armand Gatti, mais c’est un créateur d’une modernité interdisciplinaire qui utilise la marionnette, la musique, l’architecture… Le groupe Dunes de Madeleine Chiche et Bernard Misrachi… Briciole, qui est la plus importante compagnie italienne en jeune public, venait beaucoup aussi.
C.P : Je me souviens d’un spectacle de Georges Aperghis, avec la soprano Frédérique Wolf-Michaux… Et l’arrivée des idoles africaines en clôture de l’exposition Poésure et Peintrie, sur un train à wagons plats dans la cour de la Friche. A l’époque, il y avait encore les rails.
P.F : Il y a eu Helter Skelter [opéra de Fred Frith, mis en scène par François-Michel Pesenti] préparé à la première Friche, boulevard Magallon, et donné au théâtre Toursky. Les musiciens du projet, semi-pros et amateurs, se sont constitués en groupe : Que de la Gueule ! Ils sont les premiers à avoir bénéficié d’un studio à la Friche. Après eux, il y a eu IAM. Mais IAM, cela a provoqué un débat. Certains pensaient qu’il y avait des gens plus intéressants à accueillir… Il y a eu aussi Claude Régy. Il venait pour travailler avec les élèves de troisième année de l’Erac [Ecole régionale d’acteurs de Cannes]. Il arrive en décembre pour une semaine de présélection et, évidemment, tombe en plein dans une vague de froid. Il me dit : « Je veux bien revenir, mais je veux un lieu complètement neuf et 20° de température permanent, sans entendre le bruit de la soufflerie… ». On est allé chercher des gens qui carènent les bateaux pour les murs. On a trouvé une soufflerie plus puissante pour pouvoir l’éloigner de la salle. Au final, Régy est resté et c’était vachement bien.
Et puis il y a eu les tournages. La première demande est celle de la production de Karim Dridi qui devait faire un casting local pour son film « Bye Bye ». Au final, il s’installe et la Friche devient un camping de production. Robert Guédiguian, qui est devenu plus tard président de la Friche, a beaucoup tourné aussi. Puis d’autres, comme Claire Denis, qui, elle, a failli être présidente… Cela créé de l’emploi, de l’activité… Et de l’image. Et c’est comme ça que l’idée de l’îlot 2 arrive.
C’est un peu ça l’histoire de la Friche. Tu fais, mais ce n’est pas à toi de maîtriser ce que ça va devenir.
C P : C’est le rôle de la Friche : le développement t’échappe. Et si tu prétends t’en occuper, tu te plante. Certains projets ont fonctionné de manière incroyable… D’autres, non.
P.F : Et puis, il y a aussi le multimédia. La Seita nous a proposé d’accueillir les images de synthèse du festival Imagina. Et Les internautes associés, avec Christian Artin, sont venus installer un cybercafé, le premier de France. On a découvert une manière de faire : quelque chose apparaissait, puis, à un moment donné, devenait suffisamment puissant pour vivre de manière autonome. Et moi, cela m’importait parce que les projets sont portés par leurs auteurs. Et qu’il faut leur donner le maximum de responsabilités.
C.P : D’un coup, il s’est passé des trucs hallucinants. Des mômes que ça n’intéressait pas, se mettent à écrire et à parler parce qu’ils veulent faire du rap et devenir IAM.
P.F : En arts plastiques, je ne revendiquais aucune compétence. Donc, j’ai tout de suite essayé de créer un équivalent à Massalia et aux Bernardines pour produire. J’ai demandé à Christine Breton [conservatrice, chargée de mission à la Ville] de nous proposer des choses. Elle m’a présenté un groupe d’étudiants qui sortait de l’école d’art : Astérides, avec Gilles Barbier. Ils ont commencé à amener une touche professionnelle. On a aussi accueilli le vernissage de la première intégrale en France de Jean-Michel Basquiat, organisée par les musées de Marseille. Bernard Blistène trouvait que la Friche collait bien à son univers… C’est là que Jean Nouvel a découvert le lieu.
La Friche était un projet qui n’avait pas de projet, mais qui n’arrêtait pas de passer le futur au présent. On a toujours pensé qu’on allait inventer quelque chose mais on considérait que d’abord, il fallait tester. On avançait comme ça. C’est pour cela que je plaide la confiance pour les chefs de projet et pas l’obligation de se plier aux normes et règles de l’institution. La liberté nécessaire au développement, c’est ce que j’ai eu avec Christian.
Il y a eu un appel d’air artistique avec cette idée-là ?
C.P : Il y avait déjà eu une tentative sympathique, les Abattoirs de Saint-Louis avec la biennale des arts de groupe, montée par Christine Breton. Après la Friche, il y en a eu partout. Lieux Publics, la Fiesta des Suds… Même la villa Bianco, un des plus beaux endroits de Marseille, en surplomb de la plage des Catalans, est devenu une résidence. On avait fait le compte des artistes européens venant s’installer ici de 1989 à 1995. C’était hallucinant. C’est allé si loin qu’un jour, Jeanne Laffitte [adjointe déléguée au tourisme] m’a dit : « Ça suffit ! On ne peut plus pousser une porte dans un endroit désert à Marseille, sans qu’un artiste dise « entrez ! ».
La Belle de Mai, c’est aussi un quartier très populaire, l’un des plus pauvres de la ville. Quand vous déboulez là, quel est votre positionnement par rapport à cette réalité ?
C.P : Politiquement, je ne pense qu’à ça. Que les enfants des bourgeois et ceux des quartiers défavorisés allaient se mélanger grâce à la musique, au théâtre, à la culture. Qu’il fallait que ce lieu devienne l’endroit où cela se produise… Ce qui a été réussi après. Grâce à IAM et au rap et, plus tard, avec les pistes de roller ou les terrains de basket.
Mais ce que je n’avais pas lu au début, c’est que pour les gens de la Belle de Mai, la Seita, ce n’était pas un lieu de loisirs, de détente ou d’enrichissement culturel. C’était le lieu du travail, où on s’était fait chier. Cela a mis du temps pour que le regard change… Après les travaux de 2013.
P.F : Quand je créé Massalia ou qu’Alain Fourneau fonde les Bernardines, on a des soucis artistiques. Mais ces soucis artistiques sont liés au public. Pour que l’œuvre prenne sa vie, il faut que le public soit le plus authentique possible et donc, qu’il soit brassé. C’était ça, nos présupposés éthiques. On arrive à la Friche, on n’a pas l’envie de ce quartier en particulier.
Cela vient plus tard. Quand on créé le festival Logique Hip Hop, ce n’était pas pour le quartier de la Belle de Mai, c’était pour tous les quartiers populaires de Marseille. Le « quartier », vu plus comme une catégorie sociologique que topographique.
C’est quand Jean Nouvel est devenu président de la Friche, début 1994, que l’on a rebrassé tout cela. Il nous a forcé à écrire ce que nous étions en train de faire. Cela a donné le « projet culturel pour un projet urbain ». Et là, on a vraiment commencé à travailler avec le quartier, avec cette dimension de proximité. C’était nécessaire, mais cela n’a pas été si évident. Tu dois comprendre que le quartier autour de toi est la première épreuve de vérité sur ton ambition d’avoir une action sur les quartiers.
À lire dans le même dossier
30 ans !
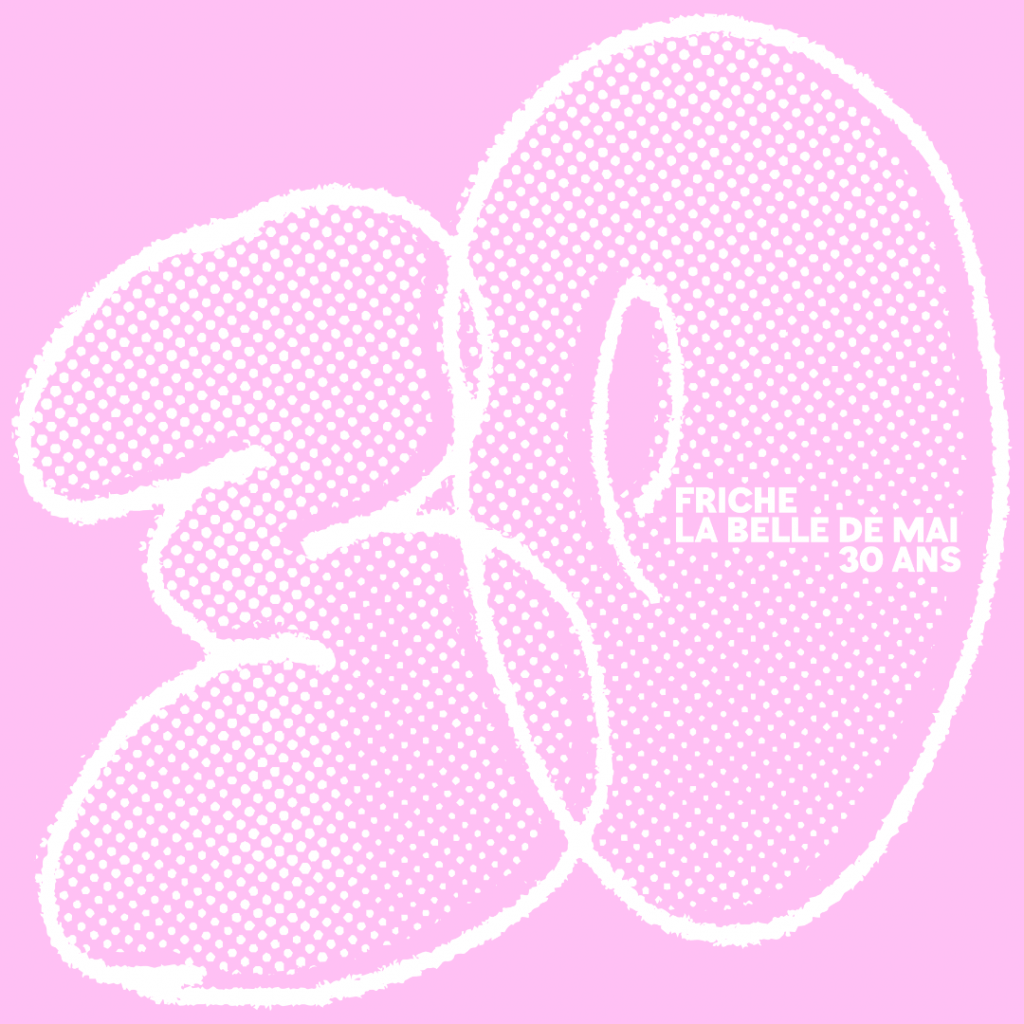
Peau neuve pour les 30 ans
Vous les avez sans doute aperçus au détour des rues de Marseille, découvrez ici l’intégralité des 6 visuels collector conçus pour les 30 ans de la Friche par le jeune duo marseillais Bortkletlend.

Entre toi et moi, la Friche
L’émission qui écoute les souvenirs et les rêves de celles et ceux qui habitent, créent, bougent et respirent la Friche.